COMMENT L'ART CONTEMPORAIN AIDE LA RECHERCHE FONDAMENTALE À RÉALISER L'IMPOSSIBLE
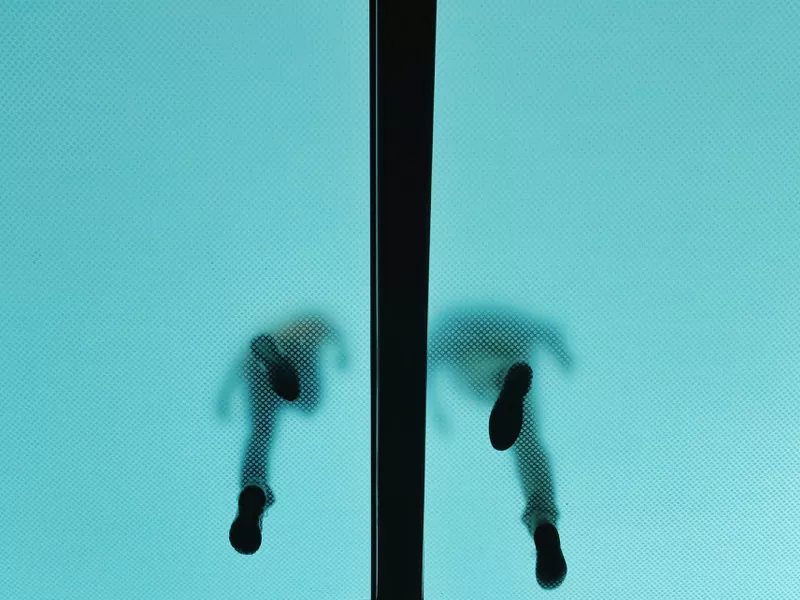
Au panthéon des idées reçues qui persistent dans le monde scientifique, on trouve la séparation du fondamental et de l’appliqué. Il y aurait d’un côté la recherche fondamentale : uniquement guidée par le goût de l’aventure intellectuelle, et donc : pure, détachée des contingences historiques, éloignées des influences économiques, militaires, politiques… De l’autre, la recherche appliquée, au service de l’industrie militaro-industrielle, et donc : souillée par l’argent, le pouvoir, le rêve de puissance, l’appât du gain… Cette distinction recoupe la distinction entre découverte et invention, dont nous avons vu (dans un précédent billet) qu’elle était infondée.
Cette distinction est essentielle au débat art-science. Car l’idée d’une recherche pure, c’est aussi l’idée d’une recherche indépendante du milieu culturel dans lequel elle s’effectue. Or, si les réponses que les scientifiques apportent peuvent échapper (dans une certaine mesure) au brouhaha qui les entoure, les questions qu’ils se posent sont toujours de leur époque, c’est-à-dire qu’elles sont profondément culturelles.
Les historiens des sciences ont largement insisté sur le contexte dans lequel Albert Einstein a fait ses premières « découvertes » : le bouillonnement intellectuel et artistique des premières années du XXe siècle, en Europe d’une manière générale, et surtout en Allemagne. Ils ont évoqué l’Académie Olympia, co-fondée par Albert Einstein, Maurice Solovine et Conrad Habicht, où les jeunes gens parlaient de philosophie et de littérature autant que de science. En revanche, ils ont rarement mentionné un fait qui pourrait sembler anecdotique, mais que je trouve passionnant à comprendre. Lorsqu’il publie en 1905 le premier de la série de quatre articles qui révolutionneront la physique, Albert Einstein travaille depuis trois ans à l’Office des brevets de Bern, en Suisse. À cette époque, de nombreux brevets portent sur un problème d’apparence anodin, mais d’une grande importance pratique : comment synchroniser l’heure des différentes gares ferroviaires en sorte d’avoir une cohérence temporelle à l’échelle d’un pays ? Cette question aurait inspiré Einstein pour élaborer sa propre réflexion sur la possibilité de phénomènes concomitants. Une réflexion dont on sait qu’elle a abouti à la théorie de la relativité.
Cet exemple nous montre comment une question issue de l’environnement culturel (au sens large) a inspiré l’une des théories les plus fondamentale de la physique moderne. Cet exemple n’est pas isolé. La même situation se produit en Angleterre, en 1838, lorsque Charles Darwin élabore la théorie de l’évolution. À ce moment, il est inspiré par trois choses, dont deux appartiennent à l’environnement culturel de son temps. La première source d’inspiration est constituée des éléments factuels (observations, fossiles, spécimens…) qu’il a recueillis lors de son voyage autour du monde (831-1836). Bien sûr, ces éléments sont largement indépendants de la vie culturelle anglaise. En revanche, les deux autres sources lui sont liées. Elles sont, d’une part, la manière dont les fermiers anglais sélectionnent leurs animaux pour un meilleur rendement, et, d’autre part, la sixième édition du livre de l’économiste Thomas Maltus intitulé Essai sur le Principe de Population. De fait, les plus grandes fulgurances intellectuelles sont toujours liées à l’arrière-fond culturel de leur temps, c’est-à-dire : la mode, l’art, le progrès technique, l’industrie, tout ce qui touche les gens dans leur quotidien.
Peut-on aller un peu plus loin que ce constat ? Je le crois. Je vais distinguer deux aspects à ce lien entre culture et science fondamentale. Premièrement, les questions que les scientifiques se posent sont culturelles. Deuxièmement, la réception qui est faite à leur réponses est culturelle.
1 | Les questions que les scientifiques se posent sont culturelles
Il est utile de distinguer deux types de questions scientifiques. D’une part, les questions que les chercheurs se posent à l’intérieur d’un champ de recherche donné, et, d’autre part, celle qui amènent à l’ouverture d’un nouveau champ de recherche.
Le premier type de questions appartient en propre au champ de recherche concerné. Elles n’ont rien (ou si peu) à voir avec l’air du temps, et tout à voir avec l’état d’avancement des connaissances dans ce champ. C’est l’équivalent de l’innovation incrémentale, en économie.
En revanche, les questions qui amènent l’ouverture d’un nouveau champ de recherches sont rarement complètement indépendantes de ce qui se passe dans la société et dans la culture en particulier. C’est l’équivalent de l’innovation de rupture, en économie. Un bel exemple nous est fourni par la découverte du premier principe de la thermodynamique.
On a trouvé dans les ruines romaines de nombreuses occurrences d’un carrousel à bougies. Dans sa version la plus banale, il s’agit d’une hélice en métal (d’une dizaine de centimètres de taille) posée sur un axe de rotation (d’une quinzaine de centimètres de hauteur). En pratique, ces hélices sont décorées de motifs si bien qu’elles ressemblent plus à un manège orné qu’à une hélice. Les Romains posaient l’hélice sur l’axe, et l’axe sur une table. Ils allumaient quelques bougies en dessous. Sous l’effet de la chaleur qui monte, l’hélice se met à tourner, entrainant les décorations. On trouve de nombreux équivalents modernes dans les foyers de tous les pays.
Fig. 1 : un exemple moderne de carrousel à bougie.
Cet objet nous montre que la chaleur (des bougies) provoque un déplacement (de l’hélice). C’est une illustration directe de ce que les scientifiques appellent le premier principe de la thermodynamique : la chaleur est une forme de travail.
Pendant deux mille cinq cent ans, tout le monde a sous les yeux l’un des principes les plus fondamentaux de la physique et pourtant cela demeure un amusement. Personne ne voit là matière à réflexion. C’est un plaisir des yeux. Ce n’est pas une chose sérieuse.
Puis, au tout début du XIXe siècle, la question du rapport entre la chaleur et le travail s’éveille dans l’esprit des savants. Elle devient une question d’intérêt. Puis, une question d’importance. De nombreuses personnes très sérieuses se posent la question de ce qu’est la chaleur, et son rapport avec le travail. Ce n’est plus un amusement de soir de Noël. C’est une question de physique fondamentale. Parmi ces gens, quatre personnes vont se distinguer. Ils sont les Français Nicolas Léonard Sadi Carnot (appelé Sadi Carnot) et Marc Seguin, l’Anglais James Prescott Joule et l’Allemand Julius Robert von Mayer.
Tout oppose ces hommes, hormis un intérêt passionné pour la physique. Carnot était un aristocrate militaire de rang. Seguin était un ingénieur spécialisé dans les ouvrages d’art. Joule était un industriel brasseur de bières. Von Mayer était un médecin.
Ces quatre personnes viennent de milieux très différents. Ils habitent en des endroits éloignés. Ils ne se connaissent pas. Et pourtant, ils vont être les protagonistes d’une course scientifique extraordinaire. Cette course va aboutir à la formulation officielle du premier principe de la thermodynamique tel que nous le connaissons.
Si l’on excepte Carnot, qui ne publia jamais les notes où il explicitait le principe, les trois autres protagonistes arriveront à la même découverte, en l’espace de quatre ans seulement, dans l’ignorance de l’avancée des autres. Les historiens donnent l’ordre suivant : Carnot (1830), Seguin (1839), Joule (1840), Von Mayer (1842).
De telles courses sont bien plus nombreuses que l’on ne croit, en science fondamentale. En 1922, Ogburn et Thomas publient une note dans le journal Political Science Quaterly (volume 37) intitulée « Les inventions sont-elles inévitables ? Une note sur l’évolution sociale ».
Dans cette note, les deux chercheurs compilent une liste de cent quarante-huit inventions concomitantes. Le calcul différentiel découvert simultanément par Newton et Leibnitz ; la théorie de la sélection naturelle, par Wallace et Darwin ; l’avion, par Langley et Wright ; le téléphone, par Gray et Bell ; l’oxygène, par Scheele et Priestley ; la théorie moléculaire, par Ampère et Avogadro…
Dans la majorité des cas, le schéma de ces découvertes est le même. Une question qui aurait pu se poser, et même se résoudre, bien avant s’anime en même temps dans l’esprit d’une poignée d’hommes qui en pressentent tout à coup l’importance. Très souvent, ces hommes sont éparpillés dans le monde. Dans bien des cas, ils ne se parlent pas et même s’ignorent. Tous prennent part à une compétition qui ne dit pas son nom, dont l’histoire ne retiendra, la plupart du temps, qu’un seul vainqueur.
À chaque fois, quelque chose relie mystérieusement ces hommes et ces femmes qui vont s’approcher séparément de découvrir. Cette chose qui les hante de la même manière sans qu’ils le sachent ne leur appartient pas en propre. Elle appartient à la société dans laquelle ils vivent, depuis laquelle ils pensent. Elle est l’environnement culturel dans lequel ils baignent.
Pourquoi la question du lien entre la chaleur et le travail ne se pose-t-elle en des termes intellectuels qu’au début du XIXe siècle ? La réponse est évidente : parce que la révolution industrielle naissait ! L’industrie avait besoin de maîtriser les moteurs thermiques pour optimiser le fonctionnement des énormes machines qu’elle désirait afin de se développer.
Brusquement, cette question importait à la société. C’est pourquoi Sadi Carnot, Marc Seguin, James Prescott Joule, Julius Robert von Mayer et d’autres, certainement, qu’on a oublié, ont mis leur intelligence en route. C’est pourquoi ils ont ouvert un nouveau champ de recherche à ce moment-là, et pas avant.
2 | La réception qui est faite aux réponses scientifiques est culturelle.
L’analyse précédente nous a montré que la curiosité des scientifiques est polarisée par la culture dans laquelle ils baignent. Les questions qu’ils se posent ne leur appartiennent pas complètement. Mais n’y aurait-il pas des exceptions tout de même ? Ne trouve-t-on pas des penseurs isolés qui arriveraient à se poser une question indépendante de leur monde et de leur temps ? Et qui arriveraient à la résoudre ? Oui, on en trouve. Mais alors, c’est la problématique de la réception de leurs travaux qui se pose. On s’aperçoit qu’il existe un deuxième filtre : la société n’entend que ce qu’elle a envie d’entendre. Un très bel exemple historique est fourni par l’invention de l’horloge mécanique par Su Sung. Je reprends ici un texte que j’ai écrit dans Le théâtre des désirs asymétriques :
« En 1077 de notre ère, l’empereur de Chine envoie l’un de ses lettrés, du nom de Su Sung, afin qu’il le représente lors d’une cérémonie en l’honneur d’un souverain barbare, régnant sur un empire situé plus au nord. Cette cérémonie tombe précisément le jour du solstice d’hiver.
Mais lorsque l’émissaire arrive, il apprend avec stupeur qu’il est en avance d’une journée sur la date de la cérémonie, contrairement à ce qu’il avait calculé suivant le calendrier officiel en vigueur en Chine.
Apprenant la nouvelle que son calendrier était imparfait, l’empereur de Chine châtia les fonctionnaires du bureau d’astronomie, puis il ordonna que Su Sung construisît aussitôt une horloge qui soit « la plus utile et la plus belle de toutes celles jamais vues ».
Le calendrier mécanique de Su Sung vit le jour treize années plus tard. Il prit la forme d’une pagode de cinq étages, haute de dix mètres. Au dernier étage se trouvait une sphère armillaire de bronze à l’intérieur de laquelle tournait un globe terrestre. À l’extérieur de chacun des étages, un défilé de personnages portant cloches et gongs sonnaient les heures. Le mécanisme était alimenté en énergie par un ruisseau.
La première horloge mécanique répertoriée dans l’histoire du monde fut donc inventée en Chine, en 1090, à l’usage de l’empereur. Elle fonctionna parfaitement pendant les quatre années où elle fut entretenue. Puis elle fut laissée à l’abandon. Elle fut pillée. On oublia le principe de son fonctionnement. Enfin, la mémoire de son existence se perdit.
La société chinoise ne voulait pas de cette invention. Elle n’en avait que faire. De même qu’un désirant ne fait pas une histoire d’amour, l’inventeur seul ne suffit pas à faire une innovation.
Pour ceux qui aiment les chiffres : 1090, c’est deux cent quarante ans avant la première horloge en Occident. C’est aussi cinq cent onze ans avant la première rencontre entre un Européen et l’empereur de Chine. C’était en 1601. Le voyageur était un prêtre jésuite originaire de Rome. Il s’appelait Matteo Ricci.
L’histoire raconte qu’il échappa de peu à la mort aux portes de la Cité interdite. Il ne dut la vie sauve qu’à l’horloge qu’il apportait en présent à l’empereur. Celui-ci se montra curieux d’une telle machine, n’en ayant jamais vu, ni même entendu parler ! »
L’histoire de Su Sung est étonnante pour au moins deux raisons. Premièrement, c’est une surprise que cette histoire soit documentée. En effet, il est très rare que l’on sache que quelqu’un a inventé une chose qui n’a jamais été diffusée. Précisément parce que son invention n’a jamais été diffusée, son nom aurait dû disparaître, comme tant d’autres génies oubliés.
Deuxièmement, le sujet même de cette invention est étonnant. Car l’apparition de l’horloge mécanique est un moment décisif dans l’histoire du monde occidental. Avant l’invention de l’horloge mécanique, on ne savait pas mesurer la longitude d’un bateau sur l’océan avec une bonne précision. Après l’invention de l’horloge mécanique, on a pu le faire. C’est donc une invention majeure dont nous parlons. Une invention qui n’a pas suscité l’intérêt de la société dans laquelle est née une première fois.
3 | Conclusion
Cette analyse nous montre combien les travaux scientifiques les plus fondamentaux sont doublement polarisés par l’environnement culturel dans lequel les chercheurs évoluent. C’est l’environnement culturel qui détermine les « bonnes questions » à se poser, celles dont les réponses compteront pour des siècles. C’est aussi l’environnement culturel qui détermine lesquelles parmi toutes les réponses délirantes (au sens étymologique : sortant du sillon) produites par les recherches fondamentales vont être amplifiées pour devenir des vérités communément admises.
Je voudrais le redire autrement, avec des mots d’enfant.
Dans nos sociétés, on a pris l’habitude de représenter l’innovateur (ou le chercheur ou le découvreur) comme un héros solitaire. À la manière d’un personnage de conte, il est en quête, et cette quête implique une lutte. Pour l’un, il s’agit de se battre contre des dragons, des géants, des sorcières, des sirènes… Pour l’autre, les ennemis sont les conservateurs, les réactionnaires, les corporations établies, les stéréotypes, la bienséance… Dans cette représentation, l’innovateur est seul contre tous. S’il triomphe, c’est malgré les autres. S’il échoue, c’est à cause des autres. Dans sa quête, la société a le rôle d’un décor.
Mais c’est méconnaître les contes que de croire que le héros est solitaire. Ce qui fait que le héros est un héros tient à sa capacité de convoquer les fées, d’interroger les crapauds, d’écouter attentivement les vieilles femmes, les malades, les enfants, les fous, tous les personnages marginaux du monde. Ces personnages symboliques incarnent la société dans son désir d’aider le héros à accomplir sa volonté. Ils vont l’aider soit en lui donnant des armes, soit en lui indiquant le chemin, soit en lui montrant la faiblesse de l’ennemi.
Dire ou seulement penser que la recherche fondamentale est pure, c’est affirmer que le chercheur est seul. C’est l’empêcher de trouver des fées pour accomplir son destin. C’est lui retirer le droit d’interroger les crapauds.
Peut-être que le lien entre la science la plus ésotérique et l’art le plus contemporain est celui-ci : dans notre monde, l’art est le nom que l’on donne à la lande des crapauds et des fées. C’est pourquoi le chercheur qui ignore l’art se prive de la possibilité de réaliser l’impossible.
Miguel Aubouy
Crédit photographique : John Robert Marasigan (unsplash.com)

